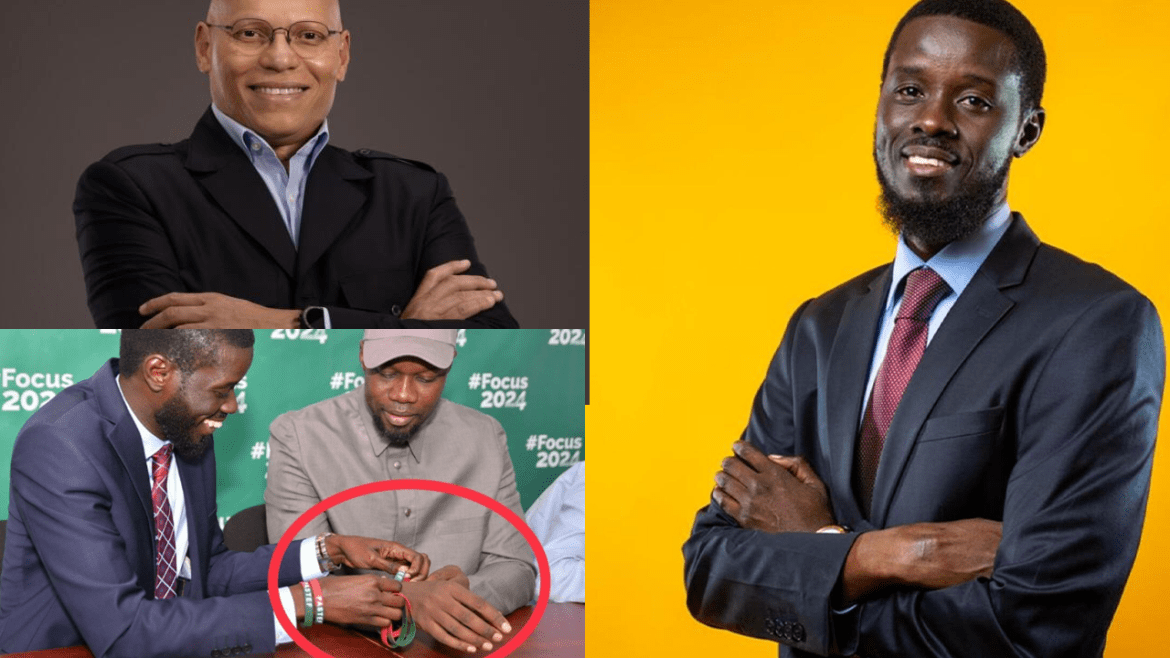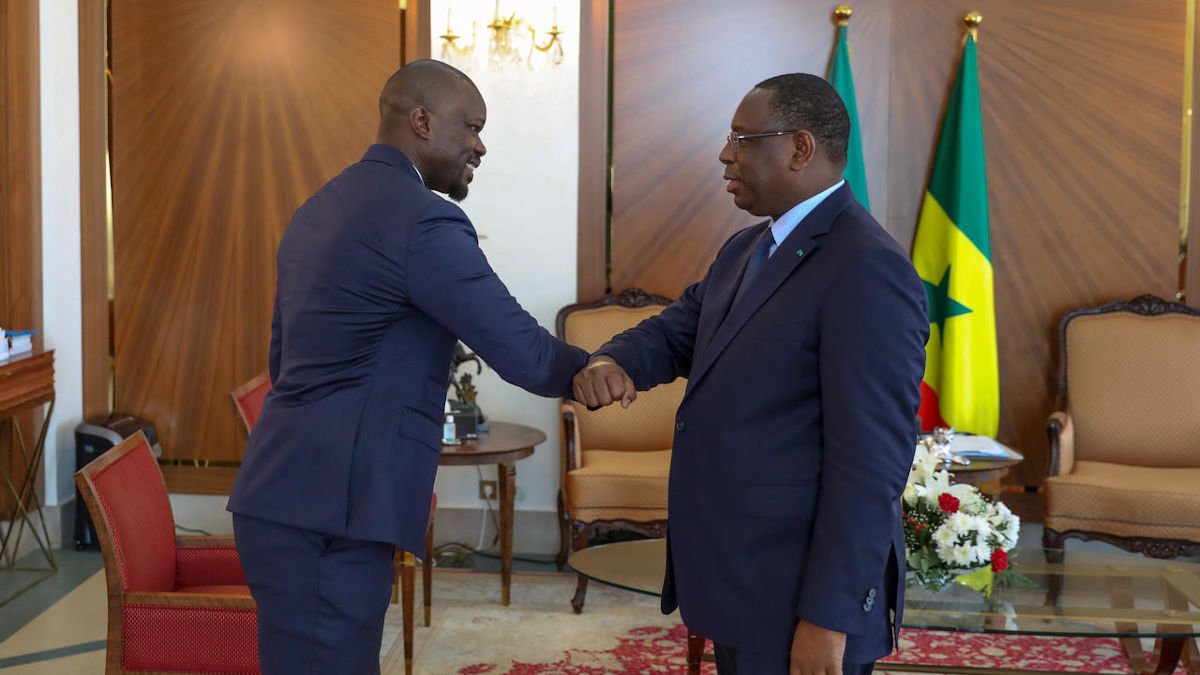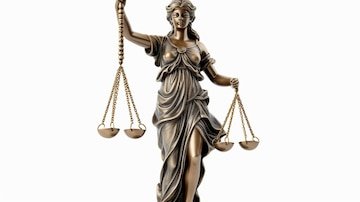La décision du Conseil constitutionnel sénégalais relative à la candidature de Mr Karim Wade suscite des préoccupations qui, analysées à la lumière des grands principes éthiques et philosophiques, nécessitent un examen approfondi. Dans le cadre des enseignements de John Rawls, il est pertinent de souligner que l’exigence de nationalité exclusivement sénégalaise peut être interprétée comme une violation potentielle du principe de justice. Rawls préconise le principe de différence, selon lequel les inégalités doivent être structurées de manière à bénéficier aux moins avantagés. La restriction de la binationalité pourrait ainsi être considérée comme une discrimination injustifiée, nécessitant une réévaluation à la lumière de ces principes.
La philosophie de Ronald Dworkin, axée sur l’interprétation éthique du droit, permet de remettre en question la rigidité de la décision du Conseil constitutionnel. Dworkin soutient que les lois devraient être interprétées à la lumière de principes éthiques fondamentaux. Dans le contexte de la candidature de Karim Wade, cela soulève des interrogations sur la justification éthique de la restriction de la binationalité en tant que critère d’éligibilité.
Concernant l’enquête de l’Assemblée nationale sur le Conseil constitutionnel, l’avertissement de Montesquieu sur les risques de la concentration des pouvoirs revêt une importance cruciale. Le principe de la séparation des pouvoirs, essentiel à la stabilité d’une démocratie, est mis à l’épreuve par cette ingérence.
En effet, une telle commission d’enquête sur le Conseil constitutionnel soulève plusieurs risques majeurs, tant sur le plan juridique que politique. Procédons à une analyse détaillée des risques associés à une telle démarche :
1. En premier lieu, il convient de constater la violation de la séparation des pouvoirs, principe fondamental dans les démocraties constitutionnelles. L’enquête de l’Assemblée nationale sur le Conseil constitutionnel peut être perçue comme une intrusion dans le domaine réservé du pouvoir judiciaire, compromettant ainsi l’indépendance de cette institution.
2. Ensuite, l’entreprise de l’Assemblée Nationale constitue une menace pour l’indépendance judiciaire du fait que les enquêtes parlementaires peuvent influencer le fonctionnement indépendant des organes judiciaires. Si le Conseil constitutionnel est soumis à des pressions politiques, cela pourrait porter atteinte à sa capacité à exercer ses fonctions de manière impartiale, remettant en question la crédibilité de ses décisions.
3. Troisièmement, il y a un risque d’instrumentalisation politique, car la création d’une commission d’enquête peut être utilisée à des fins politiques, visant à discréditer les membres du Conseil constitutionnel ou à influencer l’opinion publique. Cela pourrait entraîner des conséquences graves en termes de stabilité politique et de confiance dans les institutions.
4. En quatrième lieu, le processus enclenché sème les graines de possibles tensions entre le législatif et le judiciaire. L’enquête risque de créer des tensions institutionnelles entre l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, compromettant l’efficacité du système politique et affaiblissant la confiance du public dans les institutions démocratiques.
5. Cinquièmement, il y a l’impact sur l’état de droit, car la légitimité des décisions du Conseil constitutionnel, en tant qu’organe constitutionnel, pourrait être remise en question si une commission d’enquête parlementaire s’immisce dans ses affaires. Cela pourrait entraîner une crise de confiance dans la primauté du droit et la stabilité institutionnelle.
6. En sixième lieu, se trouve le risque de précédent dangereux : si le législatif enquête sur le judiciaire, cela pourrait créer un précédent potentiellement dangereux. D’autres institutions pourraient être sujettes à des enquêtes similaires à l’avenir, sapant ainsi l’équilibre entre les pouvoirs et la préservation de l’indépendance institutionnelle.
7. Septièmement, cela pourrait entraîner des répercussions sur l’image internationale de notre pays, du fait que les enquêtes politiques sur des institutions judiciaires peuvent avoir des répercussions sur l’image d’un pays sur la scène internationale. Cela pourrait conduire à des préoccupations quant à la solidité de l’État de droit et avoir des conséquences diplomatiques.
En conclusion, bien que la transparence et la responsabilité soient des aspects cruciaux de la gouvernance démocratique, une enquête parlementaire sur le Conseil constitutionnel nécessite une approche prudente afin d’éviter les risques potentiels liés à la violation de principes fondamentaux de la démocratie et de l’État de droit.
Quand à la situation de Bassirou Diomaye Faye, sa candidature acceptée malgré sa détention, suscite des réflexions complexes, rappelant des précédents historiques, notamment celui de Bobby Sands au Royaume-Uni.
Bobby Sands, membre de l’Armée républicaine irlandaise (IRA), a été élu député lors d’une élection partielle en 1981 alors qu’il était détenu dans la prison de Maze. Cependant, le gouvernement britannique a adopté une position ferme, refusant de libérer Sands pour qu’il puisse exercer ses fonctions parlementaires.
Cette décision était fondée sur des arguments juridiques et politiques complexes. Du point de vue juridique, le gouvernement britannique soutenait que Sands ne pouvait pas prêter serment d’allégeance à la Couronne britannique, étant donné son appartenance à l’IRA, une organisation paramilitaire en opposition au gouvernement britannique. Le serment d’allégeance était requis pour prendre fonction en tant que député. De plus, il y avait des préoccupations quant à la sécurité et à l’ordre public, considérant la nature conflictuelle de l’IRA et les risques potentiels associés à la libération de Sands.
Sur le plan politique, le gouvernement britannique était confronté à une pression intense pour ne pas céder aux revendications de Sands et de ses collègues détenus en grève de la faim. Cette position était renforcée par la conviction que céder à leurs demandes pourrait être interprété comme une concession aux activités terroristes de l’IRA. L’impasse juridique et politique a eu des conséquences tragiques. Bobby Sands est décédé en prison après 66 jours de grève de la faim, soulignant les dilemmes moraux et politiques entourant la détention de candidats élus.
En transposant cette situation au cas de Bassirou Diomaye Faye, bien que les circonstances puissent différer, des questions similaires émergent. La décision d’accepter sa candidature soulève des préoccupations quant à la possibilité de prêter serment et de prendre fonction tout en étant détenu. Les arguments juridiques et politiques qui avaient entouré le cas de Bobby Sands pourraient être invoqués, suscitant ainsi des débats complexes sur l’équilibre entre la démocratie et la sécurité nationale. Dans l’ensemble, les parallèles entre les deux situations soulignent les dilemmes éthiques, juridiques et politiques inhérents à la participation politique de personnes détenues, mettant en lumière la nécessité d’une réflexion approfondie sur la conciliation entre les principes démocratiques et les impératifs de sécurité nationale.
Pierre Hamet BA.